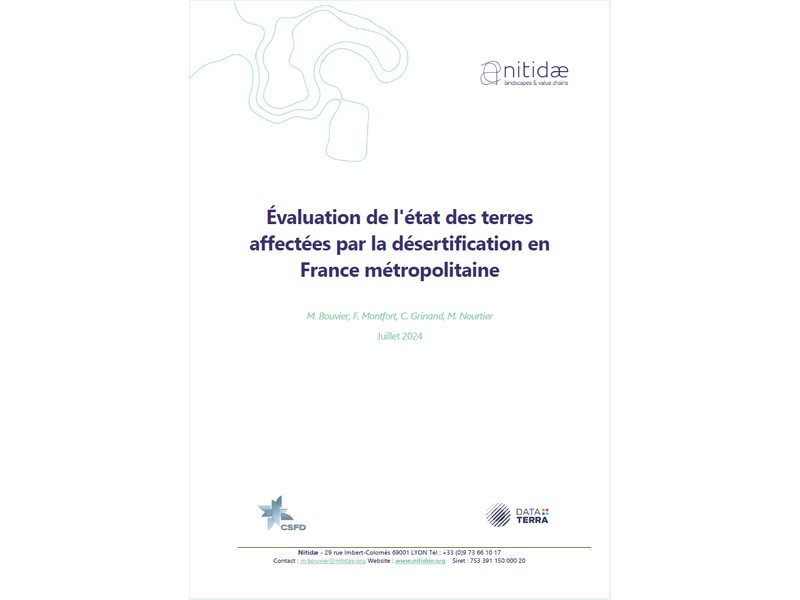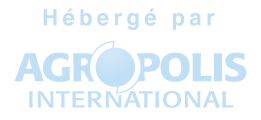En 2024, lors de la Conférence des Parties (Riyadh, Arabie Saoudite) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), la France a rejoint les pays déclarés affectés par la dégradation des terres et la désertification. En passant du statut de pays non affecté au statut de pays affecté, la France va à la fois valoriser ses actions de coopération à l’internationale et ses actions nationales entreprises de longue date pour lutter contre la dégradation des terres.
Les terres délivrent des biens et des services essentiels aux activités économiques et sociales et, de façon plus générale, au bien-être des populations. La dégradation des terres, sous l’effet d’usages intensifs de pratiques inadaptées au potentiel des écosystèmes, amplifiées par le changement climatique (événements extrêmes comme les sécheresses, les inondations), provoque une perte de fertilité (donc une baisse des récoltes), une détérioration de la couverture végétale, ainsi qu’une diminution de l’abondance et de la diversité des organismes du sol, ainsi qu’une perte de la qualité (pollution) et de la quantité des réserves en eau.
En 1992, à Rio, la communauté internationale a unanimement reconnu que la dégradation des terres est un phénomène mondial. C’est la naissance de la CNULCD dont l’objectif est de « lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces ». La désertification désigne la dégradation des terres en zones sèches, c’est-à-dire des zones à faibles pluviométries et à fortes températures (Andalousie, Sicile du Sud, Mali, Niger, etc.). Depuis la création de cette convention en 1994, l’engagement de la France a été constant. En 2015, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable, les Nations unies se sont dotées d’une cible pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres (cible 15.3).
La France métropolitaine
En 2024, le Comité Scientifique Français de la Désertification en partenariat avec Nitidae a actualisé un document de 2015.
L’objectif de ce travail était de fournir un état des lieux
i) des zones de la France métropolitaine soumises à des climats arides, semi-arides et sub-humides secs et
ii) de leur dégradation en s’appuyant sur les données récentes issues de la littérature scientifique et sur les données spatiales accessibles et pertinentes.
Les conclusions de ce travail sont les suivantes :
- En 2022, 973 700 ha (1.8% de la superficie totale) de la France métropolitaine présentent un climat aride, semi-aride et sub-humide sec, dans un périmètre circonscrit au pourtour méditerranéen.
- Au cours de la période 1993-2022, près de 39 % du territoire a vu son climat tendre vers un climat plus sec.
- 1 735 200 ha (3,2% de la superficie totale) du territoire sont considérés comme dégradés sur la base des trois indicateurs de la convention (occupation des terres, productivité de la végétation et stocks de carbone organique du sol), dont 76 200 ha (0,1% de la superficie totale) affectés par la désertification (dégradation dans les zones arides).
- Cependant, la prise en compte d’autres indicateurs de dégradation des sols (recommandés par le JRC, Joint Research Center de la Commission européenne) révèle une dégradation bien plus importante. Ainsi, en intégrant ces indicateurs, la désertification en France métropolitaine affecte 751 700 ha (1,4 % de la superficie totale).
Les projections du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) sur le changement climatique en Europe indiquent que le risque de désertification augmente (IPCC, 2019). Il est donc important de mettre en place un système de suivi de la désertification à l’échelle nationale. Pour améliorer la précision et l’efficacité de cette surveillance, il est nécessaire d’une part de s’appuyer sur les données de Météo-France pour le calcul de l’indice d’aridité, et pour caractériser l’humidité des sols. D’autre part, de sélectionner des indicateurs de dégradation des terres et les données pertinentes localement. Ces mesures permettront de mieux identifier les zones à risque et de mettre en place des stratégies de gestion durable des terres pour prévenir et atténuer les effets de la dégradation des terres.
Par ailleurs, l’utilisation comparée de deux méthodologies différentes (CNULCD et JRC) pour identifier les zones affectées par la désertification et leur évolution démontre que la méthodologie de la CNULCD pourrait être enrichie. Cette méthodologie et ces indicateurs sont négociés dans le cadre des Conférence des Parties. La France, avec l’Union européenne, pourrait donc proposer de rehausser l’ambition du rapportage de tous les États-Parties afin d’obtenir des données plus pertinentes pour l’atteinte des objectifs de la Convention.
Pour en savoir plus
• La Stratégie de la France : « Orientations Stratégiques de la France à l’international pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification » site https://www.diplomatie.gouv.fr
• Le mandat de la convention des nations unies de lutte contre la désertification : https://www.unccd.int/resource/convention-text
• NITIDAE : https://www.nitidae.org/ et https://www.lab.nitidae.org/
• Le Comité Scientifique Français de la Désertification https://www.csf-desertification.org/
• La cible 15.3 des Objectifs de Développement Durable : https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres