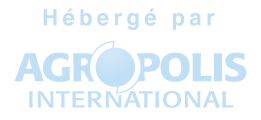Accord de Paris et neutralité en matière de dégradation des terres – 10 ans d’enjeux communs, 10 ans d’actions à amplifier
par Jean Luc Chotte, Président du CSFD
La 30e Conférence des Parties (COP30), qui s’ouvrira à Belém (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025, marquera les 10 ans de l’Accord de Paris – premier accord universel et juridiquement contraignant pour limiter le réchauffement climatique « bien en dessous de +2°C » et « poursuivre les efforts pour le limiter à +1,5°C ». Cet accord a instauré un mécanisme inédit : chaque pays doit soumettre des contributions nationales (CDN) et les réviser tous les 5 ans. Sans cette coopération mondiale, les données scientifiques indiquaient un réchauffement catastrophique de +4°C d’ici 2100, avec des conséquences dévastatrices pour les écosystèmes, les économies et les sociétés.
Pourtant, le bilan est alarmant. Le premier Global Stocktake/Bilan mondial réalisé lors de la COP28 à Dubaï a révélé un écart criant : les engagements actuels des États nous placent sur une trajectoire de +2,5 à 3°C d’ici 2100 – loin de l’objectif initial de + 1,5°C.
De nouvelles contributions nationales, attendues pour 2025 (dites CDN 3.0) devaient marquer un tournant. Mais, à quelques semaines de la COP30, seuls 64 pays sur 195 ont (en date du 30 septembre 2025) soumis leurs plans, et leur ambition collective reste largement insuffisante : une réduction de leurs émissions de 12,3 % d’ici 2035 (par rapport au niveau de 2019), contre les 55 % nécessaires pour limiter à +1,5°C le réchauffement de la planète. Les contributions des autres pays sont attendues pour Belém.
L’Accord de Paris, malgré ces retards et les critiques, a transformé l’action climatique
Attaqué de toutes parts, pour son manque d’ambition, son caractère non contraignant, l’Accord de Paris reste un cadre historique qui a permis des avancées majeures, souvent sous-estimées. Les CDN 3.0, malgré leurs limites, en sont la preuve
- Intégration du secteur des terres : Pour la première fois, une majorité de pays reconnaissent le rôle central de l’AFOLU (Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des Terres) dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Les CDN 3.0 mentionnent désormais systématiquement la gestion durable des sols, la réduction de la déforestation, ou encore la restauration des écosystèmes comme leviers climatiques
- Reconnaissance du rôle des populations locales, des femmes et des jeunes : Les plans climatiques intègrent de plus en plus les savoirs autochtones, le rôle des femmes et des jeunes dans la transition écologique, et les besoins spécifiques des communautés vulnérables. Par exemple, la Côte d’Ivoire a inclus dans son CDN 3.0 le nécessaire renforcement des capacités, l’accès équitable aux innovations technologiques, énergétiques, ressources, biens et services spécifiques en faveur des femmes, des jeunes et des enfants pour une transition climatique juste (En savoir plus…)
- Rôle des acteurs non étatiques : Un nombre croissant d’États reconnaissent le rôle de la société civile et de la science dans l’élaboration des politiques publiques, la promotion de la justice climatique et la mise à disposition de données robustes.
- Ciblage des secteurs clés : Les CDN identifient désormais les secteurs prioritaires pour l’atténuation (énergies fossiles, transports, AFOLU) et l’adaptation (eau, agriculture résiliente, santé). L’AFOLU, responsable de près de 25 % des émissions mondiales, est enfin reconnu comme un pilier de l’action climatique.
- Les synergies entre les Conventions de Rio : les États font référence aux liens entre les actions climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
L’Accord de Paris a ainsi créé un langage commun et une dynamique sans précédent : malgré les retards et les insuffisances, il a permis de placer la justice climatique, la résilience des écosystèmes et les solutions fondées sur la nature au cœur des débats.
Dégradation des terres et climat : des solutions indissociables et nécessaires
La lutte contre la désertification et la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) sont des piliers de l’action climatique, reconnus par l’Accord de Paris et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD). Voici pourquoi :
- Atténuation : Les sols stockent jusqu’à 30 % du carbone des écosystèmes terrestres (GIEC, 2019). À l’échelle mondiale, une gestion durable des sols pourrait stocker jusqu’à 80 Gt de CO₂ supplémentaires d’ici 2050 (FAO, 2020)
- Adaptation : La dégradation des terres aggrave les effets de la sécheresse et les pertes de biodiversité, rendant les populations plus vulnérables. Des initiatives montrent que des solutions existent comme
Pourtant, seulement 1 % des financements climatiques mondiaux est aujourd’hui alloué à la lutte contre la désertification (CNULD, 2023).
Vers la COP17 Désertification : un rendez-vous clé pour le CSFD et la neutralité des terres
Alors que la COP30 à Belém sera l’occasion de rehausser l’ambition climatique mondiale, la prochaine Conférence des Parties de la convention « Désertification » (COP17) à Oulan-Bator (Mongolie), prévue en août 2026, constituera un moment décisif pour concrétiser les engagements en matière de neutralité de la dégradation des terres (NDT)
Le CSFD suivra de près les avancées de la COP30 Climat en analysant les CDN 3.0 sous l’angle de la neutralité en matière de dégradation des terres. Il prépare dès à présent sa participation à la COP17. La lutte contre la désertification n’est pas un combat isolé : c’est une composante essentielle de la réponse au changement climatique (https://www.quae.com/produit/1844/9782759238040/desertification-et-changement-climatique-un-meme-combat )
pour aller plus loin :
– Les CDN 3.0 https://unfccc.int/ndc-3.0
– La synthèse des CDN 3.0 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2025_08.pdf
– Cadre conceptuel de la dégradation neutre des terres : https://www.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Annex1.pdf